Les compétences de base au service d’une citoyenneté active
[Traduction angalis - français : EPALE France
Auteur : Elm Magazine]
Le monde de la recherche. Des citoyens actifs, de la participation, des activités sociales ! Certains groupes de personnes ne parviennent pas à avoir cette vision de la citoyenneté et les apprenants les plus vulnérables peuvent manquer des compétences de bases nécessaires pour pouvoir participer. Pour que l’éducation des adultes contribue à résoudre ce problème, les études actuelles soulignent la nécessité d’équilibrer les processus individuels et environnementaux d’inclusion, et d’harmoniser ses aspects émotionnels et fonctionnels.
Maurice De Greef
Notre société semble favoriser une participation plus forte des citoyens aux activités sociales afin de leur permettre de trouver leur place au sein de la communauté. Plusieurs pays ont d’ailleurs adopté le terme de « société participative » pour encourager leurs habitants dans ce sens.
Bien que la formulation puisse paraître un peu forte, il semblerait toutefois que tout le monde n’ait pas la possibilité de participer activement à la société. En effet, certaines circonstances, opportunités éducatives manquées ou autres problématiques sociales et environnementales peuvent grandement fragiliser une partie de la population. Par exemple, le manque de connaissances en littératie ou en compétences de base (littératie, aptitudes au calcul, technologie) peut constituer un obstacle à une participation active des adultes.
Cela signifie que la citoyenneté active ne peut pas être uniquement perçue comme la réalisation de nouveaux projets au sein d’un quartier ou comme une participation volontaire à des mouvements politiques ou de solidarité, mais aussi, et peut-être avant tout, comme une simple possibilité d’intégrer la société contemporaine.
Les effets positifs de l’éducation des adultes
La reconnaissance de l’impact de l’éducation des adultes s’est améliorée dans neuf pays sur dix à travers le monde. En outre, la moitié d’entre eux s’accordent sur le fait qu’elle peut avoir un effet positif sur les capacités d’insertion professionnelle. En effet, ces apprenants semblent réussir à se faire une meilleure place dans la société après avoir suivi des cours spécifiquement dédiés, qu’ils soient formels ou informels. En d’autres termes, l’éducation des adultes peut être un levier pour accroître le taux d’inclusion sociale des citoyens vulnérables. Par exemple, les apprenants fragiles parviennent à acquérir de meilleures compétences linguistiques et semblent plus actifs, moins isolés et plus assertifs dans leur environnement proche (De Greef et al., 2012).

De l’isolement à la communauté : l’objectif de l’éducation des adultes vulnérables/photo : Börkur Sigurbjörnsson
De même, les apprenants adultes acquièrent une plus grande confiance en eux, connaissent un meilleur épanouissement personnel et se socialisent avec une plus grande aisance. Effet collatéral pour certains, un cours peut aussi améliorer leur statut sur le marché du travail. En effet, ces formations peuvent les rendre plus actifs, leur permettant de trouver plus facilement un emploi ou de s’engager comme bénévole. Enfin, les apprenants adultes semblent jouir d’une meilleure santé physique et psychologique ainsi que d’un plus faible taux de dépression.
En résumé, l’éducation des adultes favorise l’inclusion sociale et une participation plus active dans la société. Mais qu’est-ce que cela signifie pour ces apprenants ?
Pour comprendre les détails de ce processus, nous présentons un cadre s’appuyant sur une double perspective. Il permet d’illustrer à la fois l’équilibre entre les processus individuels et environnementaux de l’inclusion, et entre les mécanismes émotionnels et fonctionnels de cette intégration. Cette approche holistique des motivations d’une citoyenneté active peut aider les professionnels de l’éducation des adultes à continuer à jouer un rôle dans l’engagement des personnes vulnérables.
L’inclusion sociale comme forme de citoyenneté active
Deux perspectives doivent être prises en compte afin de décrire l’inclusion sociale en tant que résultat de l’éducation (De Greef et al., 2012).
La première perspective (ou le premier processus d’inclusion) fait référence à l’équilibre entre le poids de l’individu et son environnement social (famille, voisins, collègues, etc.). La deuxième se rapporte à l’équilibre entre l’émotivité et la fonctionnalité.
Première perspective : Individuel-Social
En premier lieu, notre comportement est déterminé par l’interaction entre nos besoins individuels et l’évolution de notre environnement social. D’une part, l’environnement peut être un facteur déterminant de changement de comportement. D’autre part, l’individu est capable de faire ses propres choix et de déterminer ses propres projets d’avenir.
Deuxième perspective : Émotionnel-Fonctionnel
En second lieu, les personnes vulnérables peuvent adhérer à des programmes d’éducation des adultes pour différentes raisons. Ils peuvent souhaiter se socialiser davantage afin de faire face à la solitude (perspective émotionnelle) ou vouloir accroître leurs connaissances en informatique, par exemple (perspective fonctionnelle). Dans ce contexte, l’inclusion sociale peut être considérée comme le point de contact entre des problèmes fonctionnels (comme la lecture de courrier) et des difficultés sociales (comme la relation avec les voisins).
La figure 1 montre l’association des deux perspectives mentionnées ci-dessus. On peut y distinguer quatre processus d’inclusion sociale : (a) activation, (b) intériorisation (être plus satisfait de soi et se sentir plus en sécurité), (c) participation et (d) connexion.

Dans ce contexte, l’activation et la participation peuvent être considérées comme des processus visant à accroître les connaissances, les compétences et les attitudes fonctionnelles pour être en mesure de faire face aux problèmes de la vie quotidienne. Par exemple, l’organisation et la lecture de votre courrier constituent une forme d’activation (au niveau individuel) et une visite chez le médecin (en contact avec l’environnement) est de l’ordre de la participation. D’un autre côté, l’intériorisation et la connexion sont des processus décrivant l’accroissement des récompenses émotionnelles entraînant, d’une part, une plus grande assurance (au niveau individuel) et, d’autre part, une plus grande socialisation (en contact avec l’environnement).
Une approche holistique
La société et les décideurs politiques doivent comprendre que la promotion d’une citoyenneté active implique également la promotion des compétences de base et de l’inclusion sociale. L’éducation des adultes jouit d’une longue expérience dans ce domaine et elle peut être un important levier pour que les citoyens vulnérables soient plus actifs dans tous les secteurs.
Mais pour jouer ce rôle, il est nécessaire que ce type de formations incluent les deux perspectives que nous avons mentionnées. Il s’agit notamment de trouver un équilibre entre l’individu et son environnement, et entre émotivité et fonctionnalité. Il faut également identifier les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ces connaissances dans le cadre des activités d’apprentissage des compétences de base visant à accroître l’inclusion sociale des apprenants adultes.
Cet article de blog a été publié pour la première fois dans ELM Magazine.
Auteur : Maurice De Greef.
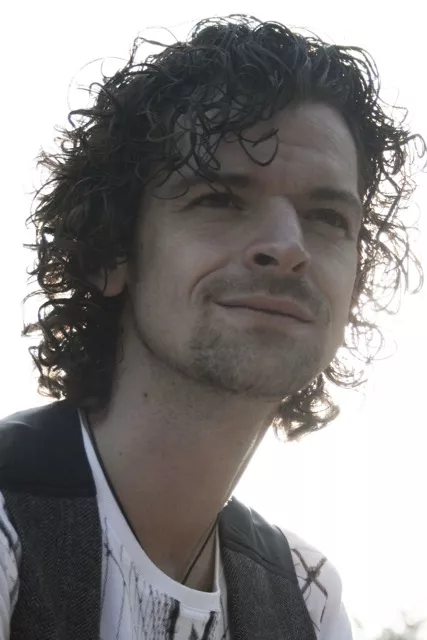
Maurice de Greef est « professeur des effets d’apprentissage sur les apprenants peu qualifiés et analphabètes » à la Vrije Universiteit Brussel. Il a obtenu un doctorat en sciences de l’éducation et s’est particulièrement concentré sur les effets de l’éducation des adultes en matière d’inclusion sociale. Il œuvre en tant que chef de projet, chercheur et formateur dans des initiatives locales, régionales et européennes dans les domaines des environnements d’apprentissage innovants, de l’élaboration de politiques stratégiques en matière d’éducation des adultes, et du développement de stratégies permettant de se rapprocher des apprenants (vulnérables). Courriel : ricedegreef@gmail.com
References
Bandura, A. (2001). Social cognitive theory. Annual Review of Psychology, (52). In J. W. Santrock (2008). Life-span development. New York: McGraw-Hill, 46 – 47.
Bandura, A. (2004). Toward a psychology of human agency.Paper presented at the meeting of the American Psychological Society, Chicago. In J. W. Santrock (2008). Life-span development. New York: McGraw-Hill, 46 – 47.
Bandura, A. (2006). Going global with socio cognitive theory: From prospect to paydirt. In S. I. Donaldson, D. E. Berger & K. Pezdek (Eds.), The rise of applied psychology: New frontiers ad rewarding careers. Mahwah, NJ: Erlbaum. In J. W. Santrock (2008). Life-span development. New York: McGraw-Hill, 46 – 47.
Berkman, N.D., DeWalt, D.A., Pignone, M.P., Sheridan, S.L., Lohr, K.N., Lux, L., Sutton, S.F., Swinson, T. & Bonito, A.J. (2004). Literacy and Health Outcomes. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality.
De Greef, M., Segers, M., Nijhuis, J. & Lam, J.F. (2014). Impact onderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen & Schrijven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid Deel A. Maastricht: Maastricht University.
De Greef, M., Segers, M. & Verté, D. (2012). Understanding the effects of training programs for vulnerable adults on social inclusion as part of continuing education. Studies in Continuing Education. DOI: 10.1080/0158037X.2012.664126.
De Greef, M., Verté, D. & Segers, M. (2012). Evaluation of the outcome of lifelong learning programmes for social inclusion: a phenomenographic research. International Journal of Lifelong Education. DOI: 10.1080/02601370.2012.663808.
Endler, N., S. & Magnusson, D. (1976). Toward an interactional psychology of personality. Psychological Bulletin, 83, 956 – 974.
Krueger, R. F., South, S., Johnson, W. Iacono, W. (2008). The heritability of personality is not always 50%: Gene-environment interactions and correlations between personality and parenting. Journal of Personality, 76, 1485 – 1522.
Lupi, C. De Greef, M., Segers, M. & Verté, D. (2011). Does Adult Education Make a Difference? Maastricht: EDAM.
Markus, H. & Nurius, P. (1986). Possible selves. American Psychologist, 41, 954 – 969. In S. Krauss Whitbourne (2005). Adult development & aging: Biopsychological perspectives. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 259.
Nye M. & Hargreaves, T. (2009). Exploring the Social Dynamics of Proenvironmental Behavior Change: A Comparative Study of Intervention Processes at Home and Work. Journal of Industrial Ecology, vol. 14 (1), 137.
UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2016). 3rdGlobal Report on Adult Learning and Education: The Impact of Adult Learning and Education on Health and Well-Being; Employment and the Labour Market; and Social, Civic and Community Life. Hamburg: UNESCO Institute for Lifelong Learning.




