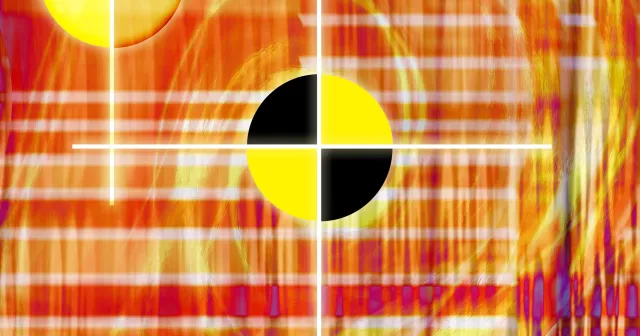Le doctorat par VAE : une autre forme de reconnaissance du chercheur
Une enquête sur le doctorat par VAE
Qu’en est-il, en France, de la délivrance du doctorat par la voie de la validation des acquis de l’expérience ?
La Direction de l’évaluation , de la prospective et de la performance a mené l’enquête auprès des services de formation continue des universités en France
Voici son bilan :
- 23 établissements d’enseignement supérieur ont délivré 104 doctorats par VAE entre 2008 et 2017 (dont 25 sur chacune des années 2016 et 2017)
- Depuis 2006, 140 demandes de VAE sur un doctorat ont reçu un avis favorable de recevabilité (première étape de la démarche).
- Le nombre d’avis favorables de recevabilité augmente en 2012 puis en 2014. Depuis 2014, on compte entre 24 et 26 avis favorables
Ce sont principalement (92 doctorats sur 104) des doctorats obtenus dans le domaine des sciences, technologie et santé (Informatique, sciences de la vie et de la santé, neurosciences, sciences agronomiques, chimie, biologie …).
Pour les 12 doctorats restants : 7 sont du domaine des sciences humaines et sociales (archéologie, psychologie, géographie, histoire , architecture) ; 3 sont du domaine des Arts , lettres et langue (sciences du langage, art, littérature et civilisation française) et 2 du domaine Droit, économie et gestion (sciences politiques, droit public).
Que nous indiquent ces chiffres ?
- Premièrement que si la demande de délivrance du doctorat sur la base de l’expérience, au regard du nombre de thèse soutenues annuellement en France (entre 12000 et 13 000) reste confidentielle (mais c’est aussi le cas pour la plupart des autres diplômes), elle tend cependant à s’installer durablement.
- Ensuite, la nette augmentation des avis favorables adressée aux candidats depuis 2012 signale une évolution des pratiques des écoles doctorales face à la VAE, encore très inégalement répartie sur le territoire français. Deux universités (Strasbourg et Paris VI) ont délivré à elles-seules 41 doctorats, le Conservatoire national des arts et métiers, 8. La même enquête signale que 56 universités (sur 78) n’ont pas encore délivré de doctorat par la VAE, soit parce qu’aucune procédure n’a encore été mises en place ou bien qu’aucun candidat ne s’est encore présenté. Parmi celles-ci, certaine ont cependant déjà émis des avis favorables et les candidats sont en train de de rédiger leur dossier de VAE.
Que signale enfin cette progression conjointe de la demande et de son admission par les écoles doctorales associées en la matière aux services de formation continue dans les établissements d’enseignement supérieur français ?
- D’une part, sans doute, que le doctorat, désormais inscrit au répertoire national des certifications professionnelles comme tous les autres diplômes est en passe d’y d’acquérir une image plus « professionnalisée » de formation par la recherche pouvant mener à l’exercice d’emploi divers de chercheurs ( et pas seulement à celui d’enseignant-chercheur).
- Dans cette perspective, l’activité de recherche, au-delà de la production de la thèse, devient (ou redevient) la cible pour l‘évaluation des acquis permettant la délivrance du titre de docteur.
- D’autre part, que l’activité de recherche y apparait de moins en moins cantonnée à la seule sphère académique de l’enseignement supérieur et couvre bien d’autre domaines d’activités économiques, particulièrement dans celles inscrites dans des enjeux de développement important. Témoignent également de cette tendance la forte augmentation ces dernières années des partenariats entre entreprises et laboratoires publics pour l’élaboration et la délivrance de thèses.[1]
- Enfin, plus largement, peut-être sommes-nous par là en train d’assister à la reconnaissance d’une autre forme de développement de la recherche dans la société, une autre alliance entre formation des savoirs et développement de l’action.
[1] Depuis plus de 30 ans, le dispositif Cifre - Conventions Industrielles de Formation par la REcherche - subventionne toute entreprise de droit français qui embauche un doctorant pour le placer au cœur d'une collaboration de recherche avec un laboratoire public.
Les travaux aboutiront à la soutenance d'une thèse en trois ans.
Isabelle Houot est experte thématique pour EPALE France.
Elle est maître de conférence à l'Université de Lorraine.